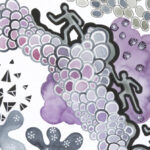Jean-Claude Dupuis : « On standardise la qualité au lieu d’évaluer la formation »
Les entreprises font-elles davantage d'évaluation de la formation ? Peut-on évaluer le ROI de la formation ? Qu'est-ce que le ROE ? Jean-Claude Dupuis, expert en économie de l'immatériel, répond à nos questions.
Expert en économie et comptabilité de l’immatériel, Jean-Claude Dupuis enseigne aujourd’hui à l’Institut de gestion sociale (IGS). Il est également conseiller scientifique au sein d’Arobase Formations, centre de formation dédié aux métiers de l’économie sociale et solidaire. Intervenu notamment en tant qu’expert en amont de la réforme de 2014, il a exercé le métier d’évaluateur en entreprise, tout en poursuivant une carrière d’enseignant-chercheur sur ces questions. Il nous parle de l’évaluation de la formation, de ROI, de ROE et de contrôle de gestion de la formation.
L’intérêt pour l’évaluation à froid vous semble-t-il augmenter dans les entreprises ?
Je ne crois pas. Ce qu’on voit sur le terrain, c’est que toutes les ressources sont mobilisées par les démarches qualité. Des dispositifs énormes sont mis en place, avec des processus très bureaucratisés. La standardisation, la normalisation qualité ont tellement occupé le terrain que l’évaluation des impacts est peu prise en compte. La qualité capte les efforts et les financements. On contrôle la formation en mettant en place des procédures en amont, plutôt que par l’évaluation de l’impact des processus en aval. Certains acteurs sont gagnants, en particulier ceux qui réalisent les audits et les certifications. D’autres préfèreraient pouvoir faire leur travail au service de la performance de l’entreprise.
La dernière réforme est souvent présentée comme une libéralisation du marché. En réalité, derrière, il y a l’Etat et une étatisation du système. France Compétences est majoritairement gérée par le public, et remplace le Copanef et le FPSPP, qui étaient gérés par les partenaires sociaux. L’Etat se porte garant de la qualité, et veille à ce que les fonds soient bien utilisés. C’est un processus de « déprofessionnalisation » comme on l’a déjà vu à l’œuvre dans le sanitaire et le médicosocial.
Comment cela s’explique-t-il ?
En partie sans doute parce qu’on a peu investi dans le métier de formateur. La représentation collective est faible, contrairement à ce qui se passe dans d’autres corporations. Beaucoup de professions organisent des campagnes publicitaires pour valoriser leurs métiers, comme cuisinier ou agent immobilier… Mais le métier de formatrice ou formateur est moins valorisé que le métier d’enseignant !
La suppression du 0,9% a réduit l’influence des partenaires sociaux et de la profession de formateur. Dans le nouveau système, il reste cependant la possibilité de négocier des contributions conventionnelles au-delà du 1%, et c’est une bonne chose. Cela permet de créer du dialogue social autour de la formation dans le cadre de la branche. Or les modèles socio-économiques diffèrent beaucoup suivant les secteurs et les métiers. A l’échelle de la branche, on peut discuter de la vitesse d’obsolescence de tel ou tel métier, de telle ou telle qualification.
Le bilan de la réforme de 2018 reste à faire, et il est probable que le système de formation sera à nouveau inscrit à l’agenda social lors de la prochaine campagne électorale.
Depuis quand évalue-t-on la formation ?
L’évaluation de la formation se pratique depuis des décennies, avec des méthodologies qui s’intéressent d’abord au déroulement de la formation elle-même, mais aussi aux impacts interactionnels et économiques, voire aux impacts financiers, qui constituent le Graal de l’évaluation pour certains. Il y a eu un vrai changement qualitatif à la fin des années 1970, avec l’émergence de l’idée d’investissement formation et de capital intellectuel.
Il y a au moins deux façons d’aborder l’évaluation. L’approche par le « retour sur attentes » (ROE, return on expectations) se demande si la formation a satisfait les parties intéressées. La recherche du « retour sur investissement » (ROI, return on investment) vise à quantifier la rentabilité, le rendement financier de la formation.
Quelle est la meilleure approche ?
Dans mon expérience, il est souvent préférable de rester dans le qualitatif, plutôt que de s’enfermer dans la course au quantitatif. Il vaut mieux raconter ce qu’apporte la formation plutôt que de vouloir compter à tout prix. On perd trop souvent de vue le fait que la comptabilité financière fait deux choses : elle compte, et elle raconte. Certes, les dépenses de formation ne sont pas intégrées, pour l’essentiel, en tant qu’investissement dans le bilan. Mais il ne faut pas oublier les annexes : il n’y a pas que les états financiers primaires (bilan et compte de résultat). Les rapports extra-financiers donnent des informations sur la politique RH, et donc sur la politique de formation. Les comptables n’oublient donc pas la formation : ils la racontent. D’un point de vue symbolique, on a l’habitude de trouver les chiffres plus sérieux. Mais la comptabilité ne s’y limite pas. Une grande partie de la production comptable relève du narratif.
Le ROI s’intéresse à la partie chiffrée, à la mesure : c’est une évaluation ex post. La démarche ROE est plus large. Elle suppose de se poser dès l’amont un certain nombre de questions : quelles sont les parties intéressées à la formation, quels sont les impacts visés, quels sont les objectifs à mesurer ? On est dans une posture de pilotage, de contrôle, de management de la formation, qui repose sur une évaluation ex ante et ex post. Une telle démarche a davantage de chances de satisfaire les parties prenantes, RH, responsables formation, managers, financiers… Il s’agit en somme d’un contrôle de gestion de la formation.
A mon sens, la valeur ajoutée du ROE est plus élevée que celle du ROI. Mais il y a des enjeux institutionnels qui poussent souvent les entreprises à vouloir prouver que la formation crée de la valeur financière.
Pourtant, l’évolution récente du règlement de l’Autorité nationale comptable (ANC) va dans le sens d’une intégration de certaines dépenses de formation aux investissements ?
Oui, j’ai été auditionné sur ce sujet, lorsque Bercy a demandé d’expertiser la possibilité d’amortir comptablement les dépenses de formation. J’ai statué dans le sens qui a été retenu par l’ANC : les dépenses de formation liées à la mise en service d’une immobilisation peuvent être amortissables.
Mais l’enjeu est ailleurs. A-mortir, c’est éviter la mort, le dépérissement du capital. Il s’agit d’obliger l’entreprise à mettre en réserve les ressources nécessaires pour renouveler ce qui a été consommé. Il s’agit d’appliquer la même logique à la formation : les entreprises doivent mettre en réserve les sommes nécessaires pour renouveler et entretenir les expertises et les compétences de leurs salariés. A une époque, La Poste suivait, parmi ses indicateurs de pilotage, le nombre de personnes non formées depuis plus de trois ans ! Et lorsque l’obsolescence des connaissances s’accélère, l’amortissement nécessaire s’accroît encore. Ce qui suppose de consentir chaque année un certain niveau d’effort de formation. C’est, d’une certaine manière, ce qui était fait avec le 0,9% imputable, avant 2014. Il s’agissait d’une sorte d’amortissement de la formation, sous forme extra-comptable, qui permettait d’entretenir les compétences génériques transversales dans les entreprises.
Cette réforme était une erreur, selon vous ?
Quand on supprime le 0,9%, spontanément, les entreprises vont se mettre à moins dépenser durablement en formation. A la place, on a mis en place une obligation de former. Mais lorsqu’on fait la promotion de la formation en situation de travail, les entreprises se disent qu’elles n’ont qu’à mettre leurs salariés au travail pour qu’ils apprennent ! Et en situation de crise, les entreprises vont avoir tendance à réduire encore les dépenses.
En militant pour l’amortissement de l’investissement en formation, on cherche à inciter à la dépense par la voie comptable. Mais l’efficacité d’un tel mécanisme reste à démontrer : une entreprise préfèrera souvent réduire sa fiscalité en comptant ses dépenses de formation en charges.
La suppression du 0,9%, pour créer un marché libéralisé de la formation, table sur l’idée que les entreprises qui forment sont les plus performantes. Avant la réforme de 2014, une étude avait été confiée à Groupama Asset Management, sur ma recommandation, pour vérifier et mesurer ce lien entre formation et compétitivité. Ils ont fait tourner tous les tests et données possibles sur le sujet à l’échelle du SBF 120. En réalité, le lien n’était pas du tout évident… Il n’est pas rare que les entreprises qui forment le moins soient justement les plus rentables, parce qu’elles récupèrent les salariés formés par les autres entreprises. C’est un comportement de passager clandestin.
La compétence est en bonne partie un bien collectif, qui doit être financé par des systèmes d’obligation. Les entreprises ne veulent financer que du capital humain spécifique. L’étude a été rangée dans un tiroir, et la réforme de 2014 n’en a pas tenu compte. On est resté sur cette idée que la formation crée de la valeur sociale et économique, ce qui est vrai globalement, mais plus compliqué que cela à l’échelle d’une entreprise.
Il y a pourtant bien un coût du recrutement, qui pourrait justifier l’investissement formation ?
C’est difficile à évaluer. Mais si les entreprises avaient intérêt à former les collaborateurs, elles le feraient certainement davantage. Elles ont besoin de preuves tangibles, et il est difficile d’isoler un effet financier positif de la formation. Au niveau macroéconomique, si l’on considère l’ensemble des investissements immatériels sur le temps long, les chiffres montrent que le seul à n’avoir jamais eu d’impact négatif est… l’investissement publicitaire. La dépense de R&D ou de formation, en revanche, n’est pas systématiquement associée à un supplément de croissance.
Bien sûr, à l’échelle de l’entreprise, les choses sont plus complexes. Il y a des effets de complémentarité. Une dépense importante en R&D peut entraîner de la croissance si d’autres conditions sont réunies – une conjoncture favorable, une bonne organisation… La même chose peut être dite sur la formation. Une combinaison pertinente d’investissements peut générer de la valeur, mais il est difficile d’isoler l’effet de la formation en soi.
Concrètement, comment s’y prend-on pour évaluer le ROI d’une formation donnée ?
L’évaluation du ROI fonctionne mieux sur des actions de formation qui ont une portée opérationnelle directe. Par exemple, la formation des commerciaux peut s’évaluer en taux de transformation des rendez-vous en prospects, etc. Pour les formations qui ne sont pas directement liées à l’opérationnel, comme les formations au management, il est possible de rechercher également le ROI, mais les impacts sont plus diffus. Il y a des méthodologies pour le faire, qui reposent sur la mesure des coûts cachés avant et après l’action de formation, comme le turnover ou l’absentéisme. Il faut pouvoir vérifier cependant que les évolutions ne sont pas liées à d’autres changements intervenus pendant la période.
Le « toutes choses égales par ailleurs » est toujours difficile à établir. Il est possible de s’en approcher par exemple en suivant deux business units aux caractéristiques comparables, la formation étant déployée dans l’une des deux et pas dans l’autre. On identifie des indicateurs à suivre, et s’ils évoluent différemment, on en déduit prudemment un effet de la formation. Mais c’est un dispositif lourd à mettre en place, et qui coûte cher.
Avant de mesurer la valeur ajoutée créée par la formation, peut-être faut-il se poser la question de la valeur ajoutée de la mesure du ROI, comparée à son coût… Qu’est-ce que la connaissance du ROI d’une formation apporte comme valeur informationnelle ? Si la mesure du ROI prend place dans une démarche institutionnelle qui vise à faire comprendre l’intérêt de la formation, c’est intéressant. Mais cela n’a de sens qu’à l’échelle d’une campagne de formation importante, s’adressant à des groupes nombreux. On parle donc de grandes entreprises. Compte tenu des coûts fixes, l’évaluation doit pouvoir être amortie sur un volume important. Dans une PME, mesurer le ROI de la formation n’est pas réaliste financièrement.
Lorsque les conditions sont réunies, on peut donc mesurer le ROI de la formation, arriver à mettre en évidence des chaînes de causalité, identifier des métriques à suivre. Et l’impact mesuré est souvent positif. Mais on peut se demander s’il n’est pas parfois plus simple et moins coûteux de demander au manager et aux collaborateurs s’ils sont satisfaits de la prestation, et pourquoi ?
Quelle est la différence avec la démarche ROE ?
Quand on se propose de mesurer le ROE, on commence par se poser la question de ce que l’on souhaite améliorer, du problème que l’on souhaite résoudre. Une action de formation est-elle le meilleur moyen d’y parvenir ? Si c’est le cas, on passe à l’étape suivante. Il faut impliquer les parties prenantes : les managers, qui seront chargés de faire en sorte que ce qui est appris sera appliqué concrètement ; la finance, soucieuse de l’utilisation des sommes impliquées ; et bien sûr les stagiaires. On identifie les indicateurs à suivre. Après la formation, on mesure la satisfaction des parties prenantes, par une évaluation à 360°.
La démarche n’a pas tellement de sens pour une action de formation certifiante ou diplômante, elle concerne plutôt les actions courtes à visée opérationnelle. Plus les parties prenantes sont impliquées tôt, meilleures sont les chances d’obtenir un bon résultat. Le processus même d’évaluation contribue au succès de la formation. La mesure du ROE participe donc bien d’un contrôle de gestion de la formation.
Si vous souhaitez vous inscrire à la newsletter mensuelle du blog MANAGEMENT DE LA FORMATION : rendez-vous ici.
Découvrez le site RHEXIS, l’externalisation au service de la gestion de votre formation.
Retrouvez les articles qui peuvent vous intéresser sur des thèmes proches :
- L’évaluation de la formation en 7 questions
- André Perret : « Je suis en guerre contre la dictature de Qualiopi »
- Seules 14% des entreprises font une évaluation des soft skills
- La formation en chiffres #53 : 10% des responsables formation déploient une stratégie d’évaluation
- L’évaluation à froid : et si on la faisait vraiment ?